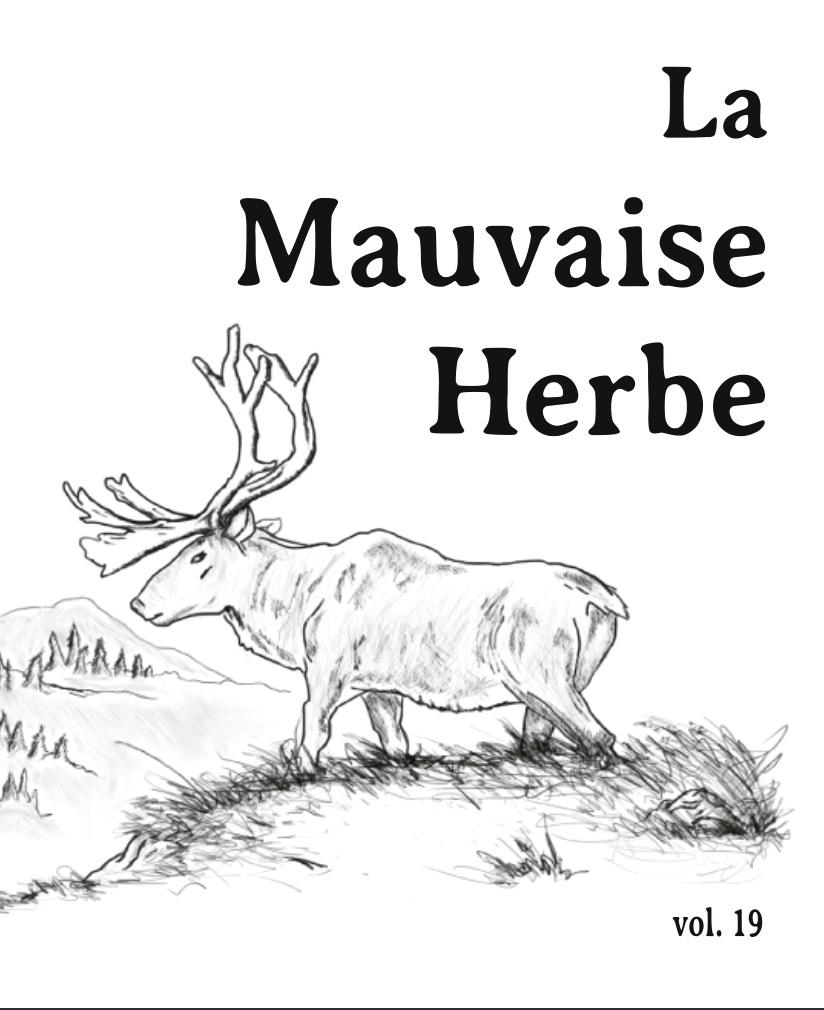(Traduction d’un article paru dans Fifth Estate)
Le domicile est où la haine est située
De Cara Hoffman
Il y a plus de dix ans, j’ai travaillé comme journaliste dans une petite ville rurale de l’État de New York. J’ai suivi les rondes de police pendant un certain temps et j’ai été chargé de survoler à chaque matin le livre où les arrestations, faits et autres événements sont répertoriés pour voir s’il y avait des crimes dignes de mention.
Lors de ma première journée de travail dans cet endroit de 1 800 habitants, le chef de la police m’a dit qu’il ne publierait pas le document. « Nous n’avons aucun crime à signaler », a-t-il dit. « seulement des domestiques. »
« Si quelqu’un vole l’épicerie ou est arrêté pour CSI (conduite sous l’influence) », il a dit « Je vous le ferai savoir ».
Dans d’autres journaux régionaux, une partie de mon travail consistait à réviser le livre du quartier général de la police d’État et des services de police locaux, qui n’ont pas hésité à me le donner. Ces documents étaient de longues listes de noms d’hommes, suivi des crimes qu’ils avaient commis.
Travaillant comme journaliste policier, même pour les plus petites publications, les modèles suivants émergent. Les crimes «domestiques» – harcèlement, traque, attouchement, coups et blessures, viol et menaces de mort se produisent à peu près à la même fréquence chaque semaine. Les seuls autres crimes commis aussi souvent étaient des infractions liées aux drogues.
Je n’ai pas vécu dans une région particulièrement violente du pays, mais encore, ces histoires, ces « domestiques », se répètent dans chaque creux et flanc de colline, créant ainsi une atmosphère de terreur pour les femmes qui les vivent, suffisamment omniprésente pour être immémorables, considérées comme insignifiantes à plus grande échelle.
Invariablement cependant, les personnes connues pour avoir maltraité les autres, si elles ne sont pas empêchées, commettent des actes plus violents. Comme l’homme qui a assassiné l’enfant de deux ans de sa petite amie, ou l’homme qui a massacré un troupeau de vaches avec un fusil de chasse et qui a ensuite mis le feu à sa maison parce qu’il était «en colère contre sa femme», ou le diplômé qui a égorgé sa femme dans un parc public, ou l’homme qui a violé et tué une adolescente de treize ans et a coulé son corps sous l’eau en position debout entre deux bennes à ordures. Ou les hommes qui ont violé, assassiné et enterré une femme de vingt-deux ans et ont jeté son corps dans un fossé près d’une réserve autochtone, espérant mettre la police sur une fausse piste.
J’ai couvert des crimes comme ceux-ci dans le Rust Belt et dans les communautés agricoles, il y avait peu de variation dans la manière cynique dont ces crimes étaient reçus par le public et par les forces de l’ordre.
Cette insensibilité constitue sa propre forme de propagande; un message clair que pour les femmes, c’est comme lancer les dés; si elles finissent ou non dans ce fossé, cela dépend de leur propre comportement «bon» ou «intelligent» ou «prudent». L’omniprésence de la violence à l’égard des femmes envoie aussi le message de se dissocier de notre propre corps, de le voir d’une certaine manière, ruiné et traité comme une ordure, et à peine le voir.
Cette invisibilité imposée fait que chaque acte de brutalité semble discret – vu comme des disputes entre deux personnes et non pas comme des crimes qui font partie d’un système fondé sur la haine, un système aussi ancien et cruel que le racisme. Un système qui pourrait amener un chef de la police d’un milieu rural, aussi récemment qu’au début des années 2000, à croire qu’agresser et terroriser un être humain n’était pas un crime, mais que voler une épicerie l’était.
Une fois, après avoir quitté la municipalité de 1 800 habitants, je suis tombé sur le chef de la police à un kiosque de crème glacée. Il portait son arme – un fait rare. Je lui ai demandé pourquoi. Un homme a eu des problèmes avec sa dame, a-t-il dit, alors il leur a rendu visite. L’homme la retenait dans leur maison, menaçant de la tuer et de se suicider après. Tout est réglé, dit-il avec un haussement d’épaules, personne n’a été blessée.
Avec les révélations continues à Hollywood et dans les médias, les déclarations des femmes dans les arts, la campagne #MeToo tenant les hommes responsables de leurs actes, il est facile de penser que nous sommes au milieu d’un tournant décisif pour les femmes qui travaillent dans le domaine de la culture.
Il est tentant de penser que ce moment décisif pourrait toucher toutes les femmes, qu’ensemble nous nous levons, qu’un jour bientôt il y aura moins de harceleurs et de violeurs sur le livre de police répertoriant les crimes de la journée, moins de fusillades de masse par des hommes qui ont commencé par battre une petite amie. J’aimerais bien le croire.
Je crains que ce ne soit l’inverse, que le traitement des femmes vivant dans des régions, comme le nord des Appalaches et dans ce que l’on appelle avec un air béant les flyover states [États qu’on ne fait que survoler en avion], dicte beaucoup la culture de la misogynie dans ce pays. Et, à aucun cas, le nombre de fois que le mot #MeToo a été inséré dans un statut Facebook n’a changé la menace implicite de violence physique et de sanction économique qui continue d’être imposée aux femmes dans tous les secteurs de la société, et qui enhardit les hommes violents.
On ne peut pas parler de genre sans contexte.
La réalité économique est que les femmes appartiennent à une classe d’individus qui, aux États-Unis, ont été empêchées par la loi de voter jusqu’en 1920, qui ont été empêchées pendant des siècles d’accéder à l’éducation, de posséder des biens, d’avoir des comptes bancaires privés, d’obtenir leurs cartes de crédit (jusqu’en 1974), à qui on a dit qu’il était naturel pour elles de travailler plus dur et de recevoir un salaire moindre, et qui, même rendues aux plus hauts postes, doivent maintenir une vigilance perpétuelle pour éviter les agressions physiques et l’exploitation par des personnes qui nous détestent pour notre sexe et profite de notre manque de puissance.
À quoi ça ressemble?
Chaque femme qui accepte un comportement coercitif a, au plus profond d’elle-même, une compréhension que la résistance peut mener à la malchance d’une sœur. Chaque femme qui prend la parole connaît les risques potentiels. La perte d’un emploi, l’intimidation ou pire.
Dix mille femmes sont assassinées aux États-Unis chaque année par des hommes, dont la moitié étaient autrefois leurs partenaires intimes. C’est le double du nombre de soldats tués dans les guerres en Irak et en Afghanistan – chaque année. Meurtre de masse sur le plan de paiement à crédit. Si un changement doit se produire, cela se reposera sur les femmes ayant compris que le visage qui regarde au ciel situé dans le fossé est le nôtre.
Le fait qu’il n’y ait pas de mot comme lynchage ou pogrom pour décrire la violence sexiste, pas de mot comme l’apartheid pour décrire des siècles d’oppression, de meurtre et d’inégalité avec lesquels les femmes vivent, ne peut cacher le fait que le sexisme est une campagne de terreur – celui qui n’attire l’attention que lorsqu’il déborde et prend la vie de spectateurs.
Devin Kelly, le tireur de l’église du Texas en 2017, qui a commis le pire meurtre de masse de l’histoire de l’État, avait un système de soutien répressif et misogyne qui lui permettait de passer de l’envoi de textes menaçants et de la maltraitance de femmes au meurtre de sang-froid de 26 personnes. Il y a eu des veillées et des discussions sur le contrôle des armes à feu et des débats sur les raisons pour lesquelles certaines fusillades sont qualifiées de terrorisme et d’autres non.
Mais à la fin de la semaine, ce même nombre de femmes avait été assassiné par des hommes et personne n’a dit un mot.
Cara Hoffman est l’auteur de trois romans, dont So Much Pretty et, plus récemment, Running, un choix de l’éditeur du New York Times. Elle vit à Athènes, en Grèce.
FIFTH ESTATE # 406, printemps 2020, Vol. 55 n° 2, page 17 https://www.fifthestate.org/archive/406-spring-2020/this-is-what-domestic-terrorism-looks-like/