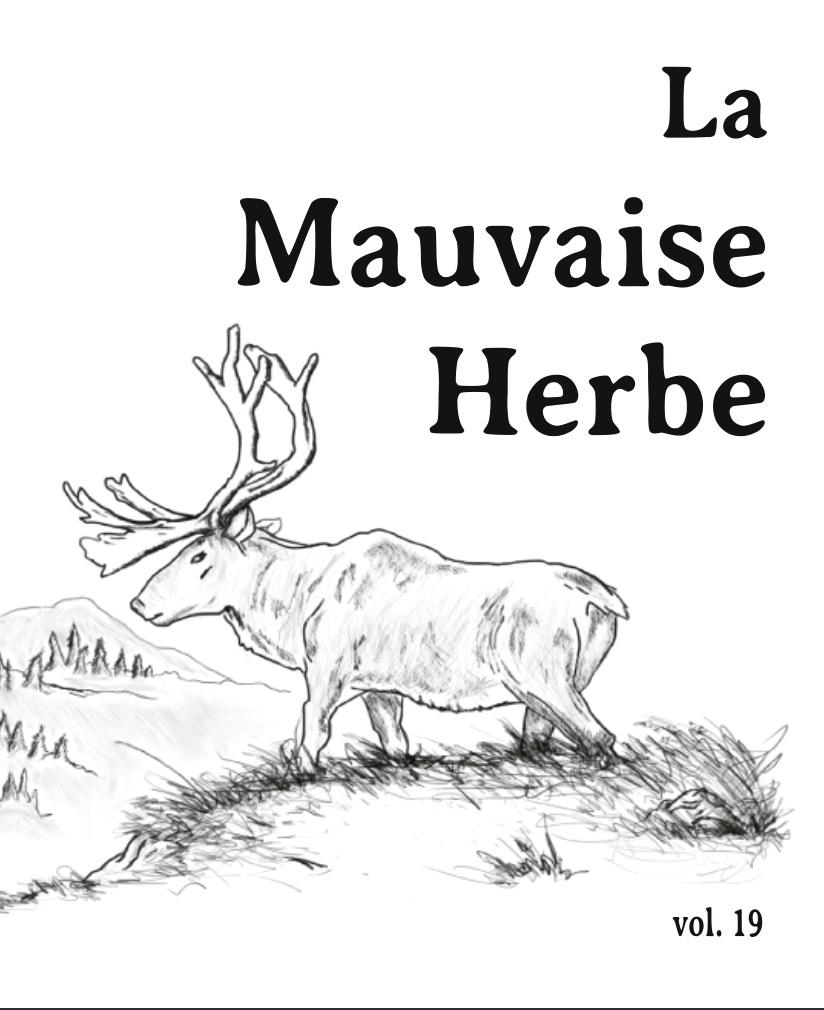Dans une société en polarisation où la droite et la gauche s’arrachent les définitions de l’identité et du terroir, la relation qu’on entretient avec le « pays », au sens de paysage, demeure étrangement consensuelle. Quelle que soit la position sur la carte politique, la proximité avec le concept de nature et l’amour du beau qui en est issu est difficilement critiquable. Étrange puisque l’écologie, l’environnement, l’économie, la destruction du monde et ses représentations culturelles devraient se situer au cœur des débats. D’où la nécessité d’écrire ce petit texte. Il cerne le reflet de ces enjeux vis-à-vis d’un mode d’exploitation économique et écologique du paysage, la petite ferme.
Le sujet est glissant sur beaucoup d’aspects; on s’y attache à des conceptions romantiques de la communauté, à des visions injustes de l’économie et on y oublie les relations défaillantes de notre monde avec le vivant et le territoire au nom d’un idéal rose bonbon. Tout aussi problématique que notre société, la ferme bio-locale séduit sur des bases trompeuses, mais fort attirantes. Avec l’essor des lieux de formation tant au niveau collégial que dans les universités, des savoir-faire pratiques et des connaissances académiques, avec les séries téléviséesi et les documentaires, avec les business en start-up qui veulent développer des parts d’un marché alimentaire toujours plus trendy, ce n’est qu’un début.
Ce texte propose de revoir quelques notions qui sont à la base de l’ASC (agriculture soutenue par la communauté) et de les déconstruire.
La communauté comme base?
Il est généralement admis que la ferme locale est celle qui agit sur une petite échelle; elle ne vend pas ses services sur le marché international ou même sur un marché national. Elle est au service de sa communauté d’acheteurs. La communauté est généralement définie en langue française comme : un État ou des biens appartenant à plusieurs personnes; une identité dans la manière de penser et dans des habitudes partagées; par un groupement de personnes vivant ensemble dans une commune afin d’échapper au modèle social dominant; à une religion.
C’est cette notion de « communauté » qui vend la ferme locale sur le marché alimentaire. Le sentiment de partager avec la campagne et les personnes y habitant. Dans un monde où il est lieu commun d’attribuer les malheurs aux multinationales, aux gouvernements, aux politiciens et aux bureaucrates de tous genres, nouer des liens avec des petites entreprises et acheter local semble une voie d’action tout ce qu’il y a de plus logique. À la fois action personnelle pour reprendre contrôle de son alimentation et geste collectif parce qu’économique (acheter c’est voter, dit Équiterre), soutenir son fermier-ère c’est un truc « bien ». On touche ici à l’identité d’une façon extrêmement consensuelle. Soutenir sa communauté, sa localité et l’industrie responsable d’un simple geste de consommation.
La logique citoyenne et marchande repose toutefois sur un paradoxe : la vaste majorité des « communautés » d’acheteurs urbains ou suburbains des « pays riches » où l’agriculture bio de petite échelle est en croissance ne sont pas organisées sur un partage des ressources communes. Elles ne sont pas des communautés aux sens traditionnels. Leur unité de façade dépend plus de Netflix, du système d’éducation national et de l’industrie de l’information que de la réciprocité, de l’Église du village et des traditions entre voisins co-dépendant-e-s économiquement. Il reste néanmoins quelques fermes familiales qui fonctionnent à l’ancienne, sans grands intrants industriels, mais elles s’inscrivent marginalement dans le modèle du retour à la terre qui fait la marque de commerce de l’ASC.
Dans le cas de la majorité des fermes locales, elles ne sont pas une communauté de biens. Elles n’appartiennent pas à ses client-e-s ou a ses voisin-e-s. Ce sont des entreprises privées appartenant à des particulier-ère-s qui peuvent très bien n’entretenir presque aucun lien de solidarité avec les voisin-e-s. Les client-e-s se procurent donc une communauté branchée-rurale à travers leur bouffe. Les producteur-trice-s génèrent une image de marque ruraliste et candide. Chez les fermier-ère-s, le soin apporté à l’image de commerce est un aspect important de la business.
Ce qui créé la communauté est un rapport marchand « humain », comme le crédit à l’achat, les cadeaux à l’abonnement, les petits produits transformés à la main ou les corvées et fêtes à la ferme où les client-e-s peuvent être invité-e-s. La communauté de la ferme est définie comme les client-e-s potentiel-le-s situé-e-s dans une centaine de kilomètres du lieu de productionii. Dans ce contexte, la solidité de l’entreprise agricole est liée à l’entente passée avec les client-e-s. Ceux et celles-ci s’accordent avec les agriculteurs-trice-s sur les limites du sentiment de communauté généré.
Le bénéfice est mutuel : un sentiment de communauté se développe dans un lien marchand basé sur la confiance entre productrices et client-e-s. Ils et elles s’entendent que la fiction de la localité permet une niche économique sur lequel leur pouvoir, au sein du système capitaliste, est accru. Plusieurs personnes ne sont même pas conscientes de cette fiction mais croient en un discours localiste, ce qui revient au même.
La notion de communauté en ASC ne s’applique que vis-à-vis des habitudes de consommation marchande et des gestes de bénévolat ou de gratuité occasionnels. Les manières de pensées partagées peuvent également y trouver un point d’entente autour de photos d’enfants qui jouent dans un champ ou de jeunes fermier-ère bronzées qui présentent de beaux légumes avec le sourire aux lèvres. De préférence avec un coucher de soleil.
L’agriculture :
S’il est maintenant plus clair que la ferme locale repose sur un sentiment de réciprocité marchande, qu’en est-il de sa place dans un système de production globalement capitaliste et déshumanisant? L’activité agricole à petite échelle est en elle même systémique : elle dépend du grand capital et de ses moyens financiers, de ses infrastructures.
Elle nécessite un grand apport en technologies : serres, machinerie, outils de construction, automatisation, plastiques et filets, etc. En fertilisation produite industriellement : engrais verts, fumiers et composts. En semences préparées et emballées dans divers pays. Sans parler des formes d’énergies fossiles pour les tracteurs, les véhicules de livraison et le chauffage des serres. Elle dépend de l’électricité pour les plus petites machines, la réfrigération des récoltes, etc. Le savoir « paysan » est essentiellement partagé via des forums, des ateliers organisés par des réseaux nationaux ou internationaux qui dépendent de l’internet.
La vente des produits est tout autant dépendante des superstructures. Elle se fait par les sites de vente sur le web, les technologies de paiement par stripe aux marchés publics, les cartes débit ou de crédit. Tout cela pour générer un capital qui sert à payer à la banque les intérêts sur l’achat de la terre, l’hypothèque des bâtiments, etc. En ce sens, les fermes bio-locales d’aujourd’hui sont tout autant dépendantes du grand capital que les petits paysans auto-suffisants du moyen-âge l’étaient du féodalisme et de ses garanties sociales et économiques.
Ce qui fait en sorte que les fermes « à petite échelle » sont un maillon toujours chancelant entre les intrants agricoles importés, les lieux occupés, les marchés de proximité et le flot de capital. En ce sens, l’image de commerce des fermes ne peut être qu’un barème négocié pour conserver la crédibilité d’une niche économique.
Le côté sexy de la ferme locale : l’intempestif
Si le portrait économique réaliste de la ferme est si peu subversif, alors pourquoi lui attribuer un potentiel de « révolution » alimentaire? Pourquoi dire qu’elle va « changer le système » de production? La notion d’intempestif rend bien justice à ce qui fait le charme du mouvement actuel de retour au terroir. [Du latin intempestivus, hors de saison, de tempus, temps. Qui est fait à contretemps, se produit mal à propos ou apparaît comme inconvenant]iii. En effet, dans une société du pré-fait et du prêt à consommer, l’idée de prendre en main ses propres moyens de production et de vendre ses produits aux gens qui nous ressemblent et qui cherchent eux et elles aussi à sortir du superficiel est délicieusement intempestif. Un peu anachronique de produire avec la traction animale sur 1 à 3 acres en 2018. Sexy et steampunk de « gosser » des panneaux de régulation de serres et une station de ventilation avec une plate-forme arduinoiv et des composantes importées de Chine. Brancher des lignes d’arrosage patentées et les installer à l’aide d’une machine soudée à la main. Trippant d’apprendre à réparer des tracteurs des années 1980 et de bâtir la machinerie à partir de plans produits par les ateliers paysans français. Et ne vous trompez pas, vos fermier-ère-s modernes font tout ça, et beaucoup plus. Le retour du potentiel de débrouillardise après trois décennies de solutions académiques, théoriques et sèches de la part de nos institutions, c’est « hot ».
Malheureusement, ce rêve de l’agriculture bio comme auto-suffisante ne correspond pas à la réalité du marché, comme vu plus haut. La construction de connaissances que cet essai à l’autonomie au sein d’un système demeure extrêmement instructif pour ceux et celles s’y consacrant, les fermier-ère-s. Peut-être y a-t-il là une subversion du système de production. Elle serait axée sur une quête personnelle de la part des personnes la pratiquant, qui s’émancipent individuellement d’un monde capitaliste par l’acquisition de savoir-faire alternatifs.
Rapidement, cette quête des technologies faites « à la main » devient, sur la ferme, la pierre d’assise qui permet les économies d’échelles. Comme le temps économisé par la nouvelle machine à laver les légumes, « gossée » avec des tuyaux de PVC et une vieille laveuse, ou celle qui permet de préparer les buttes de terre tout en intégrant les engrais verts, soudée lors d’un week-end entre bricoleux et bricoleuses en hiver. Ces économies deviennent bientôt la norme adaptée à la taille du marché de niche. Elles permettent de générer ces doux profits dédiés, par exemple, à l’achat du nouveau char pour aller voir famille et ami-e-s urbain-e-s, l’ancien étant mort d’épuisement après 500 000 km, 8 ans de service et de nombreuses réparations de fortunes, paix à son âme.
L’image anachronique et le capitalisme
Si l’image intempestive de l’entreprise agricole de proximité demeure le « bling » de sa plus-value, les pratiques qui permettent de l’atteindre sont toujours bien ancrées dans le monde capitaliste. Au delà de l’image à contretemps, inconvenante, l’agriculture alternative en Amérique du Nord demeure une histoire de propriété privée, d’exploitation de la main-d’œuvre, souvent migrante, et de rapports de domination entre maîtres et apprenti-e-s. Des fermes bio québécoises qui préfèrent travailler entre blancs avec des saisonnier-ères peu formé-e-s, des woofers et des stagiaires à celles qui assument que le marché canadien de l’agriculture fonctionne à main-d’œuvre latino et qui en embauchent quelques-uns, la condition du travail n’y est pas plus reluisante qu’ailleurs. L’agriculture, avec son absence parfaitement légale de code du travail, demeure un de ces secteurs difficiles où les fériés, les jours de maladie et les heures supplémentaires n’existent pas. On y est fier-fières de « travailler dur » sans se plaindre, sur le bon vieux modèle du conservatisme social de l’ancien temps.
Cette tendance ne se trouve pas contredite par le flux d’aspirant-e-s propriétaires qui sortent chaque année des écoles d’agriculture bio de Saint-Hyacinthe, Lapocatière et de Victoriaville, ou de la ferme d’André Desmarais, les Quatre-temps. La différence d’avec la situation d’il y a 20 ans, quand le mouvement a commencé, est que le marché est maintenant compétitif. La main-d’œuvre se doit d’être performante et les propriétaires de fermes compétent-e-s pour survivre. Les réseaux de propriétaires de fermes bio-locales s’enflamment d’indignation et d’horreur quand l’idée du salaire minimum à 15$ de l’heure est évoquée, car les marges de profits sont maigres! C’est déjà probablement leur salaire, alors l’idée de payer des employé-e-s peu expérimentés, qui demanderont à être formé-e-s, le même salaire qu’eux-elles leur fait dresser le poil sur les bras. À moins d’augmenter sensiblement le prix de leurs produits. Voici le nœud du problème; la petit ferme doit développer une niche durable. Si elle la perd en haussant ses prix ou en ayant une image moins attirante que la concurrence, elle devient obsolète dans le marché alimentaire et devra fermer ses portes.
Les solutions proposées touchent alors l’organisation du marché. Grossir la part des produits bio-locaux requiert des structures qui externalisent les coûts de production ou de mise en marché hors des entreprises. Comme dans tous les autres secteurs de l’économie. Ce n’est pas sans rappeler les premiers regroupements des agriculteurs canadiens du 19ème et du début du 20ème siècle, qui ont fondé les structures de coopération et de protection nationale du marché agricole que nous connaissons maintenantv.
La CAPÉvi (Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique), avec ses paniers d’hiver, ses kiosques dans les marchés publics et ses instances de partage des technologies marque un point tournant dans cette organisation du marché et cette externalisation nécessaire des coûts depuis 2013. Tout comme Équiterre l’a fait il y a plus de 20 ans en mettant en place le réseau des fermiers de famille pour les coûts de mise en marché et en réseau.
La piste des subventions viables (ou du moins à la hauteur des ambitions des fermier-ères) est évoquée, à l’instar du fonctionnement de l’agriculture conventionnelle. Des instances nationales furent créées dans les dernières années, telles l’Union Paysanne, pour demander l’intervention des gouvernements dans le marché bio-local. En un mot, une fois la niche dépassée par ses circonstances d’émergence, il faut assumer le côté parfaitement business et intégré au marché des fermes afin de les faire prospérer.
Ces moyens de promotion sont tout autant de gauche que de droite, regroupant des pensées libertariennesvii autant que coopératives ou nationalistes. L’achat systématique par les institutions publiques de la bouffe bio-locale est invoquée, de même que plusieurs autres solutions parfaitement applicables et réformistes. Un bon exemple de cette façon d’envisager l’agriculture de proximité pour le futur est présentée dans le documentaire de Marc Séguin « La ferme et son État », sorti en salle en 2017. Globalement, on peut constater que l’intempestif et la conscience du profit à faire dirigent le mouvement de la « révolution alimentaire », mais que la conscience politique de l’agriculture bio-locale est dépourvue d’analyse de classe sociale et d’anti-autoritarisme.
Des pistes de solution?
À travers les années passées dans ce milieu, j’ai croisé de nombreuses personnes qui se sont engagées dans l’agriculture bio-locale avec un espoir réel de « changer le monde », ou du moins d’y trouver une place pour eux-elles qui n’implique pas de détruire son environnement et son prochain. Beaucoup en sont sorti-e-s amèrement déçues, ou bien ont appris à faire des compromis. J’ai eu du mal à apprendre à fermer ma gueule quant aux modes d’exploitation, aux hiérarchies et aux violence interpersonnelles qui sont monnaies courantes sur les fermes du 21ème siècle. L’idée d’écrire ce court texte a germée d’une discussion avec un woofer qui travaillait sur la ferme où j’étais. À la question existentielle de « Comment on fait alors pour sauver le monde avec l’agriculture? », à laquelle le dude semblait vraiment croire qu’il aurait une réponse concrète, je n’avais rien d’autre à répondre que « Fermer la ville et abolir le patriarcat? ». Ça a mis un « fret » dans la conversation.
La réponse « fermer la ville » vient, toune des goules en susviii, du fait que les villes, qui concentrent plus de la moitié de la population du monde alors qu’il y a à peine 100 ans l’humanité était une espèce à plus de 90% rurale, représentent l’accumulation des richesses et la violence systématique du capital envers l’écologie. Si vous voulez plus de précisions sur le sujet les textes passés de la Mauvaise Herbe vous fourniront plus de lecture que nécessaire.
La partie abolir le patriarcat vient du fait que les violences et les actes de domination quotidiens nécessaires au fonctionnement d’une entreprise agricole sont issus de cette vieille culture du travail et de la famille conservatrice qui nous empoisonne l’air depuis le féodalisme. Probablement depuis plus longtemps en fait, mais il est question ici du Canada, qui prend ses racines dans le régime féodal de la Nouvelle-France.
À la lecture de ce texte vous aurez compris que l’ASC contemporaine ne réglera rien aux problèmes sociaux que nous vivons; elle a déjà de la difficulté à reconnaître les oppressions qu’elle reproduit et tente de se frayer une part du marché capitaliste en bâtissant des niches économiques toujours plus importantes. Toutefois elle dégage un potentiel de compétences fort utiles pour survivre sans méga-structures, bien qu’encore nettement insuffisantes. L’imagerie du retour à la terre produit pour l’instant un clash intempestif et sexy entre rigorisme économique et innovation, qui invite au conservatisme en même temps qu’aux valeurs de solidarité et d’entraide. Sans confronter aucun de ses problèmes inhérents, l’ASC ne peut toutefois que se diriger dans un mur et devenir un outil d’aliénation, c’est à dire de dépossession. Les producteur-trice-s agricoles et les client-e-s perdent de vue les rapports de solidarité qui étaient nécessaires afin de bâtir une niche économique plus ou moins indépendante du « gros capital ».
Entretenir l’illusion qu’il est possible de sortir du capitalisme sans sortir des rapports marchands est une grossière erreur; se complaire dans cette illusion est dangereusement naïf.